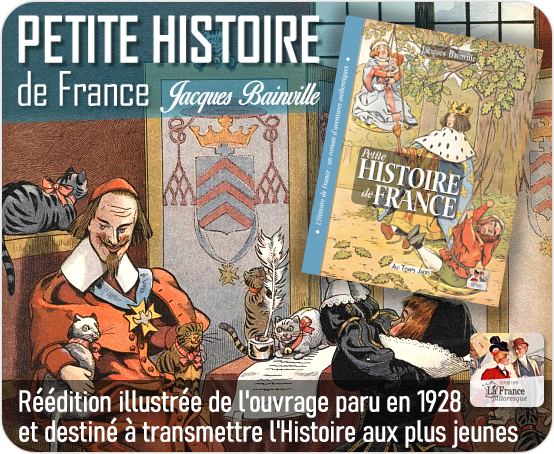Il y a un an qu’Edmond Rostand est mort, écrit l’académicien et futur secrétaire perpétuel de l’Académie française René Doumic, dans la Revue des deux mondes en 1919. Depuis un an, nous n’avons cessé de mieux comprendre l’étendue de la perte qu’a été pour les lettres françaises la disparition prématurée de ce poète enlevé dans toute la force de son beau génie. Si, au lendemain de sa mort, je me suis abstenu de parler de lui et de son oeuvre avec quelque développement, c’est qu’en vérité devant la tombe fraîche ouverte de celui que j’avais connu presque enfant, je n’aurais su dire que mon affliction. Aujourd’hui, dans le recul d’une année, j’essaierai de le montrer tel qu’il m’apparaît et d’indiquer la place qui lui appartient dans l’histoire de notre littérature.
La Provence nous l’avait envoyé — Edmond Rostand est né à Marseille le 1er avril 1868. Elle avait mis en lui la douceur de son ciel clément, la tendresse de ses brises parfumée. Il était de la race de ces troubadours qui ont chanté l’amour courtois et rêvé de princesses lointaines. De Marseille, sa ville natale, il voyait les vaisseaux partir vers cet Orient pour lequel l’amour de Mélissinde faisait naguère s’embarquer Geoffroy Rudel. Du Midi provençal il avait encore la gaieté légère, un tour d’esprit gentiment railleur, un don d’apercevoir le côté plaisant des choses et de s’en amuser. Il avait ce goût de la galéjade qu’un autre Provençal a si bien noté chez ses compatriotes et chez lui-même. Il était du pays de Daudet. Il était de ces tambourineurs qui vont « jouant du triste et du gai tout ensemble. »

| Edmond Rostand. Photographie de Paul Boyer (1861-1952) |
|
Et il était aussi de l’autre Midi, plus âpre, plus ardent, le Midi de Gascogne. Il a dit dans la Maison des Pyrénées l’attirance qu’exerçait sur lui cette région pyrénéenne, en lisière de l’Espagne. Est-ce parce qu’il tenait d’une grand’mère gaditane une goutte de sang espagnol ? Est-ce tout simplement parce que ce coin de terre est celui où il retournait chaque année pendant la période bénie des vacances, pour y retrouver la maison de famille, la maison douce et riante où de la glycine montait à son balcon. C’est là qu’il goûtait le charme de s’appartenir, de flâner, de rêver en liberté. Parce qu’il y fut parfaitement heureux, tout ce pays lui devint cher. Témoin certains vers de Cyrano où tremble une larme : lui aussi, à entendre « les vieux airs du pays au doux rythme obsesseur », voyait s’évoquer le val, la lande, la forêt, « et la verte douceur des soirs sur la Dordogne. »
Témoin cette nostalgie qui lui fît, au lendemain de ses grands succès, choisir un cadre de nature voisin de celui où s’était écoulée son enfance, pour y créer cette propriété de Cambo, merveilleux jardin ouvert de tous côtés sur les Pyrénées. Luchon fut pour lui ce qu’avait été pour Victor Hugo la « vieille ville espagnole » de Besançon. Il y respira ce « rien de bravade espagnole » qui, deux fois déjà, au début du XVIIe siècle et au début du XIXe, avait passé les monts. Et il y prit encore ce goût pour la truculence et le gongorisme, qui est, lui aussi, partie intégrante de nos deux romantismes.
Midi de Provence ou Midi de Gascogne, ils ont mis du soleil dans son imagination, de ce soleil qui égaie jusqu’à la tristesse et jusqu’à la misère. La fée qui s’est penchée sur son berceau, c’est la bonne vieille qui portait dans sa brouette un morceau de soleil. Et quand il écrira l’Hymne au soleil « sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont », ce sera, de sa part, une action de grâces.
Il a grandi dans une de ces familles privilégiées, où le culte des lettres est de tradition, comme la noblesse morale. On y était, de naissance, poète et musicien. Le père d’Edmond avait traduit Catulle en vers délicats ; son oncle, qu’aux derniers temps de sa vie il ne manquait pas d’aller voir un seul jour, avait fait des opéras. Douceur exquise d’un foyer français dans un milieu cultivé :
Mon père traduisait Catull
Et ma sœur déchiffrait Mozart ! |
Edmond Rostand y prit une fois pour toutes l’habitude de toutes les élégances : lui aussi, c’est à l’âme surtout qu’il devait les porter. Jamais chez lui de ces traits de vulgarité, qui, même chez de grands écrivains, décèlent la médiocrité des origines. Tant pis pour ceux qui ne sentent pas le prix de cette distinction.
Cet enfant du Midi était un silencieux. Son occupation préférée, c’était de pêcher à la lune. Il a lui-même décrit, un jour, cette pêche, la plus belle qui soit au monde. Le rêveur faisait prévoir le poète. L’auteur dramatique aussi s’annonçait. Il y avait, à Marseille, de l’autre côté de la rue, un marchand de pupazzi. Edmond traversait souvent la rue et ramenait quelque vedette nouvelle pour la troupe de marionnettes dont il s’était fait l’imprésario.
Citons enfin, puisqu’il a lui-même éprouvé le besoin de l’évoquer dans une circonstance solennelle, l’une des influences qui semblent avoir le plus agi sur lui : celle du « correspondant » qui le faisait sortir pendant ses années de collège. Il « arrivait brusque, pimpant, la moustache ébouriffée, l’œil bleu : je le vois encore. Il m’enlevait gaiment, me transportait dans des paysages bien choisis, et me contait de belles histoires de guerre et d’amour. Il me ramenait ébloui et reposé ; il m’avait appris de tout sans avoir l’air de rien ; j’entends encore sa voix charmante ; il s’appelait Villebois-Mareuil. » C’était l’époque où Rostand était à Paris pour y achever ses études.
Que furent ces études ? Je puis en témoigner, écrit René Doumic, n’ayant jamais oublié ce matin de novembre 1884, où le petit Marseillais de quinze ans débarqua dans la Rhétorique que je professais alors au collège Stanislas. Sur l’exemplaire des Musardises que je tiens de son amitié, je lis, tracé de sa main, que ce souvenir est celui d’un « mauvais élève. » Il le disait en souriant ; d’autres l’ont répété gravement, parce qu’il est convenu que, pour devenir un maître de la langue française, il importe de n’avoir pas commencé par en apprendre la grammaire. La vérité est qu’Edmond Rostand fut un brillant rhétoricien. Il se peut qu’il eût un Victor Hugo dans son pupitre et qu’il crayonnât des vers dans les marges. Il se peut qu’il n’ait pas eu pour tous les exercices scolaires la même ardeur. C’est qu’il réservait le meilleur de son jeune labeur à la composition française. Ses « discours », lus tout haut en classe, lui valurent les « premiers feux de la gloire. » Nous comptions bien qu’à la fin de l’année il aurait le prix d’honneur au Concours général : il n’eut pas un accessit , dix collégiens, ce jour-là, furent tenus pour meilleurs écrivains qu’Edmond Rostand. Tout de même, il savait faire les « discours » : on le vit bien, le jour qu’il prononça sous la Coupole son éblouissant discours de réception.
C’est vrai que son premier livre passa inaperçu. Mais c’est vrai aussi que les Musardises de 1890 (Les Songes Creux, — Poésies diverses, — Le livre de l’Aimée), si elles contenaient des développements agréables et faciles sur des thèmes romantiques et de jolis vers d’amour, ne se présentaient pas comme un recueil fort original. C’est à distance qu’il est curieux de les relire parce que nous avons assisté à l’épanouissement de ce qui n’y était qu’en germe. La première pièce, qui sert de dédicace au volume, célèbre les ratés, les génies incomplets et ridicules, poursuivants d’un idéal qu’ils n’atteindront jamais ! Puis c’est le « vieux pion » surnommé Pif-Luisant, poète et nasigère, — déjà ! Puis le « vieux poète » qui meurt incompris, et dans le Chien et le loup, le bohème féru de son indépendance. Ainsi s’ébauchait, dans les Musardises, la figure du raté sublime auquel l’auteur de Cyrano devait bientôt conférer l’illustration.
Son vrai début, ce furent les Romanesques (1894), qui sont ses Contes d’Espagne et d’Italie. Le poète s’y rattache à une longue tradition littéraire : ce sera toujours une des caractéristiques de son oeuvre. Il y a là beaucoup de Musset et un peu de Banville, mais il y a aussi du Marivaux et du Florian, et du répertoire classique et de la comédie italienne. Au pays bleu, de bons vieillards et de gentils petits amoureux se jouent des tours innocents : ils sont honnêtes et ils amusent, ils ont de la vertu et ils ont de l’esprit. Et quand on a tout dit à l’éloge de cette jolie pièce, on n’en a pas encore dit le principal attrait : c’est la jeunesse. Non pas la jeunesse impertinente et piaffante et qui plaît par ses défauts même, mais cette autre jeunesse, tendre et confiante, qui est la fleur de l’âme au matin rose de la vie. La gaieté y pétille.
À la première représentation, la pièce faisait spectacle avec le Voile de Rodenbach. Le Voile c’était encore Bruges la morte : j’ai dans l’oreille un glas de cloches, de soupirs et de gémissements. Cela ne manquait pas de talent, mais cela manquait de gaieté. On écoutait le Voile avec respect, en silence ; les applaudissements éclataient aux Romanesques. On ne put jamais ôter à Rodenbach l’idée qu’il y avait là-dessous de la cabale. Une atmosphère d’optimisme faisait de cette pièce souriante « un repos naïf des pièces amères. » Il y avait longtemps que le romanesque chez nous était discrédité : cela datait du jour où Flaubert avait fait cette belle découverte qu’il mène sûrement aux pires turpitudes. Edmond Rostand, dans l’allégresse de ses vingt ans, rapportait à ses compagnons d’âge le droit au romanesque.
Comme je le félicitais de cette brillante, vive et spirituelle entrée qu’il venait de faire dans la littérature, je me rappelle l’insistance qu’il mit à me répéter qu’il ne fallait pas le juger sur cette première oeuvre, qu’il avait autre chose en tête, tout à fait autre chose, qu’on verrait, qu’on serait surpris, que ce serait une autre manière, une autre teinte. Cette autre teinte, dont il était aisé de deviner qu’elle lui agréait davantage, cette autre manière dont il faisait plus de cas, c’était celle de la Princesse lointaine (1895).
Quatre actes de mélancolie, c’est un peu long ; et ce Moyen Age de légende et de chevalerie ne laisse pas d’être conventionnel. Mais l’idéal du poète commence à se préciser. C’est, déjà sa conception de l’amour, du seul qu’il ait voulu accepter dans son oeuvre, l’amour pur, noble, source de toutes les fiertés. C’est sa conception de la vie : Frère Trophime professe que le Seigneur gagne tout à toute chose grande et désintéressée. Et c’est la foi qu’il a dans les humbles, les petits, les obscurs, pour deviner, par un instinct qui est en eux, les inspirations les plus grandioses, et y répondre par un dévouement sans limites. Les mariniers « cœurs d’azur dans des piquants sauvages » qui, en prenant pour eux les souffrances d’une navigation périlleuse, permettent à Geoffroy Rudel d’accomplir son pèlerinage d’amour, sont les ancêtres de ces autres grands cœurs et de ces cœurs simples qu’incarnera Flambeau.
Pour ce qui est de la Samaritaine (1897), j’avoue n’avoir jamais pu m’y plaire. Au surplus, si ce fut de la part du poète une concession à la mode et au goût d’une grande artiste, on la lui a assez cruellement reprochée. On lui en a voulu d’avoir dit sur l’Évangile de si jolies choses. On a raillé sans pitié ce Jésus dilettante qui s’amuse à décrire l’anse que dessine sur le ciel le bras levé des filles de Jacob. On a feint de s’étonner qu’un auteur pût se tromper si complètement sur lui-même et ne pas comprendre que certains sujets lui sont interdits. C’est à ces détracteurs qu’il répond fièrement : « Il y a des sujets qui sont trop beaux ? Il y a des sujets qui sont trop grands ? Qui a dit cela ? Ce n’est pas un poète. Les pêcheurs de lune lancent leurs filets sans jamais désespérer de ramener l’astre. » Rostand n’avait eu cette fois que l’honneur du filet hardiment lancé ; maintenant il allait ramener l’astre.

Représentations de l’immense succès Cyrano de Bergerac. Affiche publicitaire
de 1898 composée par Lucien Métivet (1863-1932) |
|
Ce fut la merveille de Cyrano (1897). Pour expliquer le succès de Cyrano, on a écrit des volumes et on s’est ingénié en mille manières. On a répété, à satiété et sans bienveillance, que l’œuvre était venue à son heure et qu’elle avait eu grande chance, comme si ce n’était pas la coutume des chefs-d’œuvre de venir à leur heure et comme si ce genre de chance, ils ne le devaient pas à eux seuls ! Il eût été si simple de constater tout bonnement que Cyrano est un chef-d’œuvre !
Ce qu’on entend par chef-d’œuvre, c’est l’œuvre achevée, qui réalise la perfection d’un genre, l’exacte adaptation de la forme à la matière. Heureuse réussite que produit, à l’appel du génie, la rencontre de maintes conditions. Harmonie d’abord entre l’auteur et son sujet. On a justement noté l’étroite parenté d’esprit qui existe entre Rostand et les poètes de l’époque Louis XIII. Il rejoint leur romantisme à travers le romantisme de 1830. Il a comme eux le goût de l’héroïque et comme eux le goût du grotesque. Il se place entre Corneille et Scarron. Cette société qu’il évoque, il semble qu’il y ait vécu. Sentiments et tour d’esprit, il les trouve en lui-même. Il en parle naturellement le langage. Et non seulement il est du temps, mais il est du pays.
À vivre en Gascogne, il a pris l’humeur gasconne : Ce sont les cadets de Gascogne... Harmonie entre les deux éléments, lyrique et dramatique, qui trop souvent, au théâtre, se contrarient au lieu de s’accorder. Cyrano est une oeuvre toute lyrique, parce que l’auteur s’y est mis lui-même, avec sa nature, sa sensibilité personnelle, sa tendresse, ses alternatives de gaieté et de tristesse, ses aspirations au sublime et sa complaisance pour la bouffonnerie. Lyrique par la qualité de l’air qu’on y respire, par une sorte de fièvre qui y court et d’exaltation légère ; lyrique par l’ivresse verbale qui multiplie les tours d’une même idée, fait jaillir les mots pittoresques et drôles, crée les néologismes hauts en couleur ou de plaisante invention ; lyrique par la profusion des images neuves et originales et par les prouesses de rime. Ballades et rondeaux peuvent s’insérer dans la trame du dialogue : ils n’y sont pas dépaysés.
Et tandis que les drames de Victor Hugo dont on n’admirera jamais assez le lyrisme, sont du plus mauvais théâtre, Cyrano est « du théâtre » dans la plus complète et dans la meilleure acception du terme. Non pas seulement par la vie qui circule à travers toute la pièce, par le mouvement des scènes et du dialogue, par l’art de tout rendre sensible, concret et « en scène », mais surtout par la création de ce personnage de Cyrano qui est le type lui-même du personnage de théâtre, celui sur lequel se concentrent tous les regards et auquel vont toutes les sympathies.
Il est, ce Cyrano, tout action : c’est lui qui conduit la pièce. Et il est tout cœur, ayant les délicatesses et les raffinements de la plus précieuse sensibilité. Et il est tout esprit et toute présence d’esprit, ayant toujours sur les lèvres le mot prêt à partir, la riposte prompte et la réplique triomphante. Il a toutes les vertus, sans rien de ce qui parfois nous rend injustes pour la vertu. Il est brave, il est loyal, il est généreux, il a du talent ; et comme toutes ces belles qualités ne l’ont mené à rien, cela fait que nous ne pouvons lui en vouloir. Il est sublime, et comme d’ailleurs il est ridicule, on est ébloui, sans être humilié par cette vaine sublimité. Il a toujours raison, quoique absurde. Il est plus spirituel, plus courageux, plus gentilhomme qu’aucun de ses spectateurs : ils s’en consolent en songeant qu’ils n’ont pas le nez aussi long. Ils se consolent d’avoir à l’admirer en se souvenant qu’ils ont à le plaindre. Pauvre diable et diable d’homme, assez avisé pour corriger chacune de ses qualités par un défaut qui les empêche d’être haïssables ! Toute la salle, toutes les salles ont pour lui les yeux que Roxane devrait avoir.
Ainsi le seul Cyrano a réalisé au XIXe siècle la perfection de la comédie héroïque. Les romantiques s’étaient appliqués, suivant les conseils du maître, à opposer le tragique et le comique, et ils y avaient si bien réussi que les deux éléments, joints dans une même pièce, y faisaient contraste et discordance et juraient d’être rapprochés. Dans Cyrano le passage se fait naturellement de l’un à l’autre, tant les nuances en sont finement assorties ! Le théâtre romantique avait la prétention d’être une évocation de l’histoire, et n’en était que le travestissement.
Mais Rostand avait « fait ses études » et, qu’il fût poète, cela ne l’empêchait pas d’avoir l’esprit critique. Plus encore que de l’histoire, ce qui a cruellement manqué au théâtre romantique, c’est la connaissance de la vérité humaine : chaque sentiment qui s’y exprime est en désaccord avec le caractère du personnage autant qu’avec la situation où il se trouve, et l’expression ajoute sa fausseté propre à celle du sentiment. Sous la truculence ou sous la folie des propos, il y a dans Cyrano un fond d’humanité qui en a fait et continuera d’en faire le succès durable.
Ce qui achève de classer l’œuvre, c’est qu’elle n’appartient pas seulement à l’histoire du théâtre français : elle appartient à l’histoire de l’âme française. Parlant de l’émotion qui étreignit les cœurs le soir de la Fille de Roland, l’auteur de Cyrano a écrit : « Il y a des paroles qui, prononcées devant des hommes réunis, ont la vertu d’une prière ; il y a des frissons éprouvés en commun qui équivalent à une victoire ; et c’est pourquoi le vent qui sort du gouffre lumineux et bleuâtre de la scène peut aller faire claquer des drapeaux. »
Il en a été ainsi de Cyrano et c’est par là que l’enthousiaste soirée du 28 décembre 1897 — date de la première représentation de Cyrano — fut une soirée historique. Notre défaite de 1870 avait eu pour lendemain cette littérature de défaite qui fut tour à’ tour le roman naturaliste, la poésie et le drame symbolistes et décadents. Nous étions restés longtemps ensevelis dans le brouillard et dans le froid. Enfin l’esprit français sortait de ce suaire livide ; il se redressait brillant et hardi dans sa fierté lumineuse. La race s’était réveillée. C’était le signal d’un relèvement dont nous savons aujourd’hui qu’il ne devait plus s’arrêter sur la route glorieuse.
D’autres auraient été grisés, gonflés, d’un tel succès. Rostand eut seulement le sentiment qu’il lui créait de nouveaux devoirs. Car on lui a fait porter, dans l’opinion, le poids du formidable banquisme organisé autour de son nom. Ceux qui l’ont connu, savent qu’il y fut complètement étranger. Au lieu de se plaire à tout ce bruit, il ne songea qu’à le fuir. Il se réfugia dans la solitude de son lointain Cambo. Il garda toute sa simplicité gracieuse de jadis et toute sa modestie. Il n’eut plus qu’un souci : remplir sa renommée. Souci qui fut souvent une angoisse, et qui désormais domine toute son oeuvre.
La foule avait reconnu en lui quelques-unes des plus authentiques qualités de la race ; aussi l’avait-elle justement et sans qu’il l’eût cherché, salué poète national. Il rêva d’épopée. La France d’alors se reprenait de goût pour les gloires napoléoniennes : il les cueillit dans l’air. Ce fut l’Aiglon (1900). Pouvait-on rendre quelque couleur à la pâle figure du duc de Reichstadt ? Rostand voulut que, dans cette conscience partagée entre deux hérédités, celle des Bonaparte et celle des Habsbourg, un drame se soit joué qui ait eu quelque chose de shakespearien. Il a fait du fils de l’homme un autre Hamlet et n’a pas omis même les visions et les hallucinations.
Mais sans doute le « pauvre enfant » était trop frêle pour supporter le poids d’une telle création. Le rôle était trop purement imaginaire et factice et ne reposait pas sur ce minimum de réalité, dont ne peut tout de même pas se passer un personnage historique. Au contraire, depuis l’instant où Flambeau fait son entrée dans la pièce, — une des plus superbes entrées qu’il y ait au théâtre — le drame est déséquilibré, l’intérêt se déplace, il va tout entier au personnage secondaire qui émerge au premier plan ; la vague silhouette du prince souffreteux disparaît devant la solide carrure du grognard, qui revient de si loin, qui a fait le tour de l’Europe en combattant, et qui n’est pas fatigué ! C’est que ce rôle-là plonge ses racines dans le sol. Il est un résumé d’histoire. Il fait mieux que d’expliquer, il montre, il rend sensible aux yeux ce dévouement des petits, grâce auquel a été possible l’épopée impériale. Et, comme tout se tient dans l’histoire d’une nation, ce rôle qui incarne tout un passé glorieux allait être la préface de lendemains aussi épiques. Tout ce qui est dit dans l’Aiglon des grognards de l’Empire, peut se redire et s’est vérifié pour les poilus de la Grande Guerre.
J’ai toujours pensé, poursuit René Doumic, que si Rostand avait tant hésité et tant tardé à nous donner son Chantecler (1910), c’était non pour aucune des difficultés accessoires et d’ordre matériel qu’on a mises en avant, mais parce qu’il ne pouvait se décider à livrer au public une pièce qui, dans ses parties essentielles, est une ardente confession. Car tout le rôle de Chantecler n’est pas autre chose, et c’est un des plus poétiques symboles par lesquels on ait jamais traduit la fonction du poète éveilleur d’aurore.
Chantecler c’est le poète, à la façon dont le conçoit Rostand, et que lui-même il s’est efforcé d’être. Comme le coq enfonce ses griffes dans le sol pour jeter vers le ciel son cri qui monte des entrailles de la terre, ainsi le poète qui porte en lui l’âme d’une race lui donne une voix pour traduire ses aspirations les plus généreuses. Et peut-être le coq ne fait-il pas lever le jour, mais le poète fait lever l’idéal que créent son imagination et sa sensibilité. Tâche magnifique et douloureuse. Car le poète y pourra-t-il suffire ? Le souffle qu’il attend reviendra-t-il ? Et la page qu’il vient d’écrire n’est-elle pas la dernière ?... C’est là le véritable drame d’une vie d’artiste : la terreur de se survivre à soi-même. Pour l’avoir rendu avec tant d’intensité et tant d’éclat, on peut bien pardonner au poète cette débauche de lazzis, contre-partie et peut-être rançon du rôle de Chantecler.
Edmond Rostand avait vu venir la guerre : j’ai dit ailleurs son émoi devant l’horizon qu’il voyait se charger de nuages. Désormais il n’a plus su que crier sa haine de l’Allemagne et dire sa tendresse pour la France. Le Vol de la Marseillaise (1915) est à coup sûr un des plus beaux poèmes patriotiques qu’il y ait dans notre langue. Il fallait le lui entendre réciter, en merveilleux diseur qu’il était, avec cette diction de théâtre plus encore que lyrique, détachant, martelant les syllabes, jouant le poème, en faisant vivre toutes les colères et tous les enthousiasmes. D’un mouvement spontané, les milliers d’auditeurs qui emplissaient la grande salle de la Sorbonne aux Matinées nationales se trouvaient debout : ce que nous acclamions alors, en même temps que le poète, c’était le Destin de la France que nous sentions passer sur nos têtes.
Dans le volume auquel le Vol de la Marseillaise a donné son nom et où on a recueilli la production de guerre de Rostand, toutes les pièces ne sont pas de même valeur. Il suffit que quelques-unes soient de purs joyaux. Telles, la Vitre, le Faucheur basque, qui disent avec une émotion si intime ce que c’est que la France, toute la France, et les Ruches brûlées où l’abeille, « chaste buveuse de rosée », a inspiré Rostand comme elle avait inspiré le Victor Hugo des Châtiments. Telle l’Étoile entre les Peupliers, catéchisme d’une religion à laquelle on ne saurait tolérer un infidèle, la religion de la patrie, hymne qui contient ce splendide fragment épique : le dénombrement de tous ceux qui, en tous les temps et sous tous les costumes, se sont battus et sont morts pour la France. Encore doit-on rappeler qu’il faut un peu de temps et quelque recul, pour que se dégage la somme de poésie enclose dans les plus grands drames de l’histoire. Rostand n’a pu que jeter, au milieu même des événements, un premier cri de souffrance, de haine et d’espérance.
C’est d’une autre manière encore que son nom s’insérera dans le souvenir de la guerre de 1914. Dans un livre excellent sur le Théâtre de Rostand, un jeune écrivain, Jean Suberville, a écrit : « Les Saint-Cyriens qui partaient au feu avec la plume à leur casoar, réalisaient devant la mort le héros que le poète avait rêvé. Telle division s’appelait la division Cyrano ; tel corps d’armée avait pour insigne le coq Chantecler. L’immortel Cadet de Gascogne réapparaissait inlassablement sur le théâtre du front... Rostand a été aimé par les poilus de 1914. » On peut le dire en toute sûreté de conscience : c’est l’hommage dont il eût été le plus fier.

Edmond Rostand en habit d’académicien (élu en 1901 et reçu en 1903).
Photographie prise vers 1915 |
|
Le même écrivain constate : « À vrai dire, le solitaire de Cambo n’a pas créé d’école littéraire ; il vivait en marge, trop indépendant et trop désintéressé. Voilà pourquoi sa mort a suscité plus d’émotion dans la foule que dans les cénacles ; voilà pourquoi le grand public n’a pas trouvé dans les revues littéraires un digne écho du regret général, ni une louange égale à l’admiration de la France entière. Sa véritable influence apparaît dans l’âme de la jeunesse française. » Et cela vaut mieux ainsi.
Il est exact que, depuis la mort de Rostand, on a peu écrit sur lui, et qu’il s’en est trouvé quelques-uns, hélas ! pour le dénigrer sottement. Mais il faut avouer que depuis ce début de décembre 1918, trop de soucis nous ont détournés de la pure littérature. L’œuvre de Rostand a pour elle tout l’avenir. Parmi les exégèses qu’on lui consacrera, il en est une que nous appelons de tous nos vœux. Un fin lettré, Louis Labat, a été, pendant vingt ans, pour Edmond Rostand, l’ami de tous les jours, le confident de toutes les pensées. En revivant pour nous les entretiens du poète, en nous initiant à ses projets comme à ses procédés de travail, il élèverait à la chère et grande mémoire un monument qu’attendent de lui et que lui demandent tous les amis et tous les admirateurs de Rostand.
Ce qui apparaît dès maintenant dans cette oeuvre où il n’y a pas une fausse note et pas une dissonance, c’en est la forte unité. Et le même trait en fait l’originalité certaine. On peut interroger tous ses héros : ils sont de la même famille. Le Contrebandier des Musardises, en qui nous avons vile fait de reconnaître notre vieil ami Don Quichotte, s’il veut à toute force passer la frontière et rentrer en France, c’est pour y rapporter « les héroïsmes superflus. » Ce que représente Cyrano, c’est non pas la bravoure, mais ce qui la complète et la parc d’élégance.
« Qu’est-ce que le panache ? Il ne suffit pas pour en avoir d’être un héros. Le panache n’est pas la grandeur, mais quelque chose qui s’ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d’elle. C’est quelque chose de voltigeant, d’excessif et d’un peu frisé. C’est l’esprit de la bravoure. Un peu frivole peut-être, un peu théâtral sans doute, le panache n’est qu’une grâce ; mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort, celte grâce suppose tant de force que tout de même c’est une grâce que je nous souhaite. » Flambeau ne se contente pas d’être brave entre les braves et de faire tout son devoir : il « fait du luxe. » Ils auraient pu être des héros de Rostand, ce colonel Doury qui donnait pour mot d’ordre à ses hommes : le sourire, — et ces cuirassiers, célébrés par Albert de Mun, qui chargeaient dans les roses. Le trait qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils personnifient l’héroïsme à la française.
C’est Rostand qui l’a fait rentrer dans notre littérature. Tous les dons qu’il avait reçus de la nature et de la vie le destinaient à remplir celte mission. Il y fallait l’éclat du verbe, la vivacité de l’émotion, l’ampleur de l’imagination ; mais il y fallait aussi la gaieté, l’esprit et la grâce. Il fallait à ce pur Français tout ce qui lui est venu de sa Provence avec tout ce qui lui est venu de sa Gascogne. Et voici quelle a été sa récompense. Comme, jadis, une société était sortie de la Comédie humaine, de l’œuvre de Rostand il est sorti une jeunesse nouvelle à l’image de ses héros : celle de nos combattants de 1914. C’est sa gloire, — et dans toute l’histoire des lettres, je n’en sais pas de plus enviable.